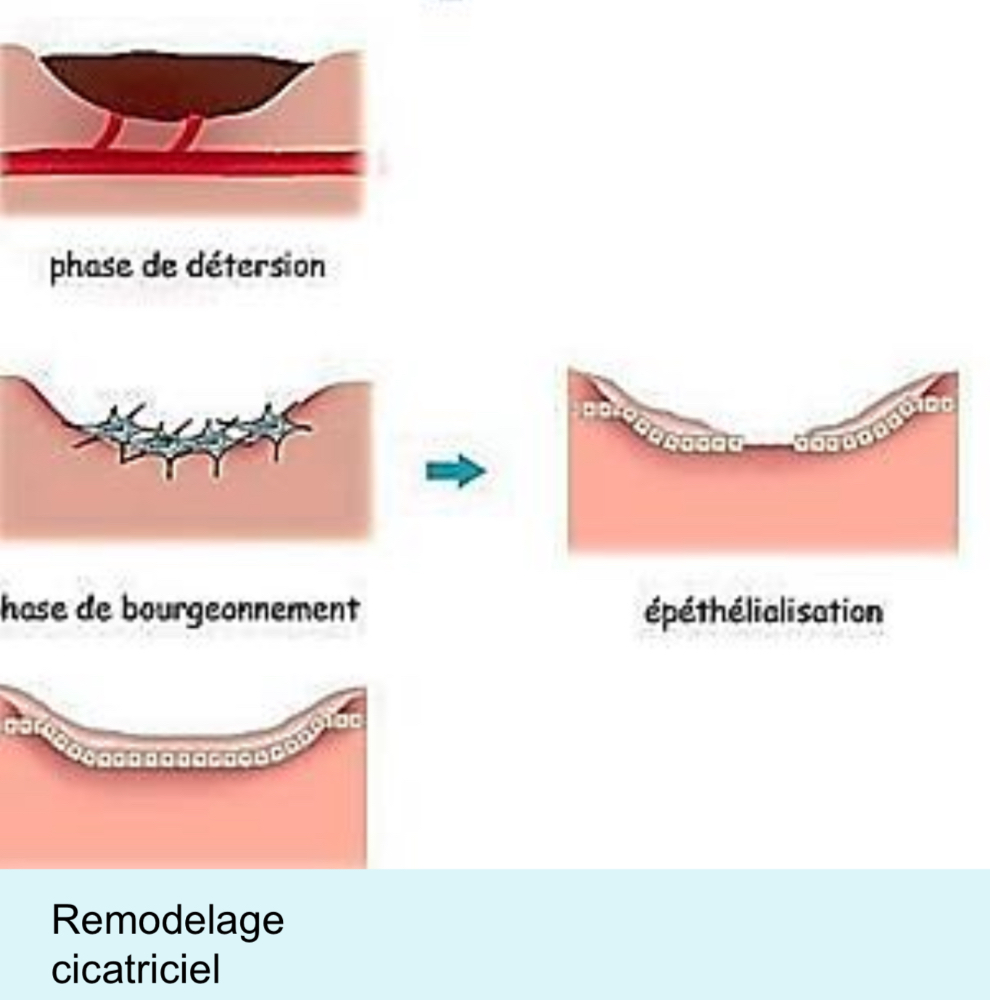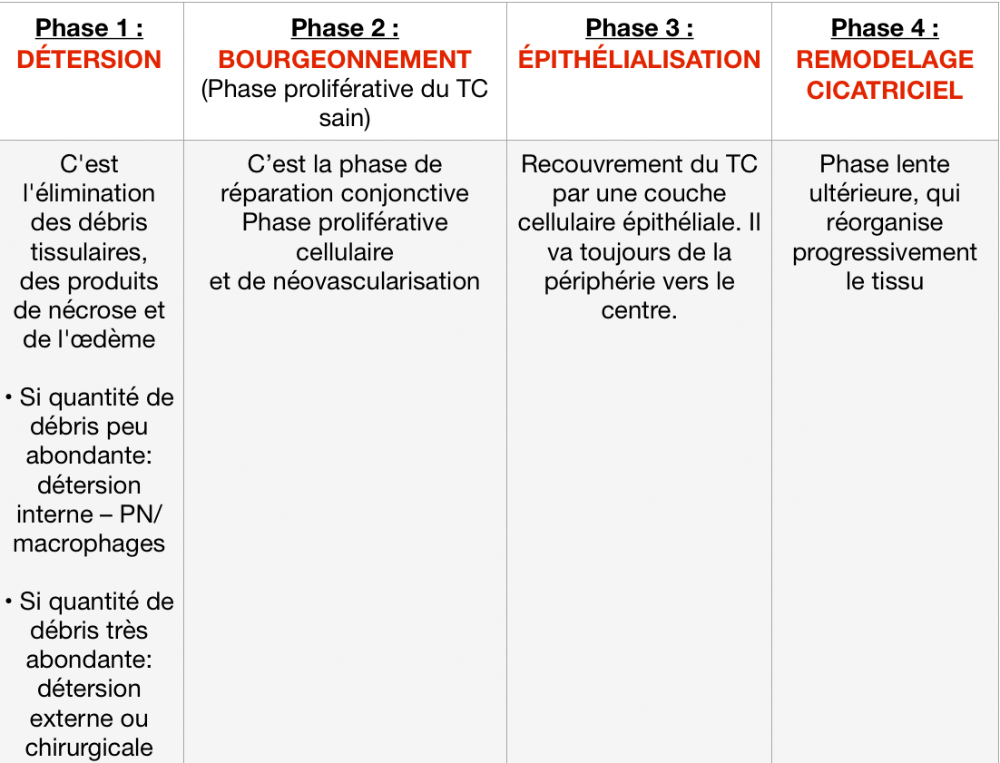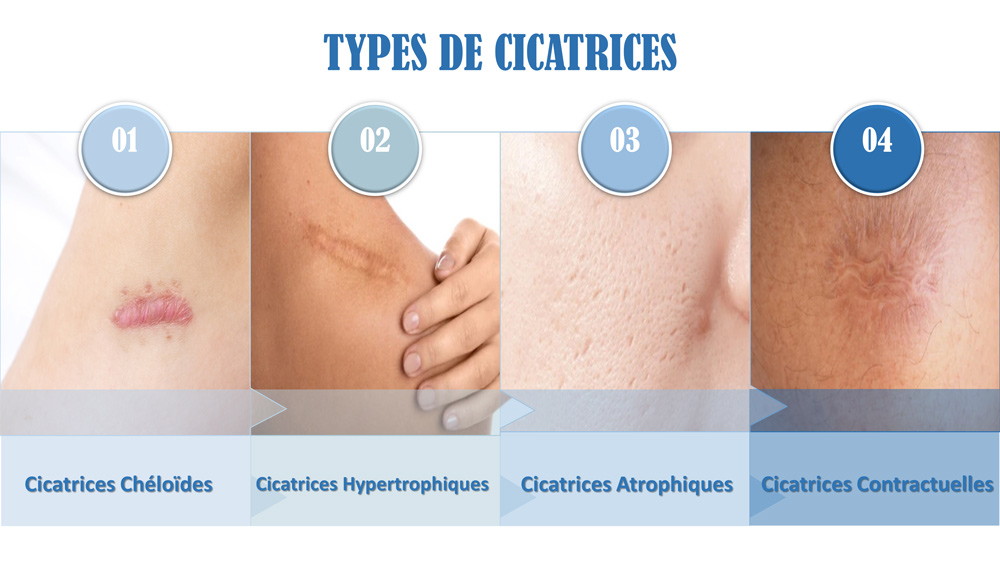Le processus de réparation fait suite à une inflammation, qui peut être causée par :
- Infection
- Intervention chirurgicale
- Blessure (plaie, fracture…)
Objectifs du processus de réparation :
- Restreindre le site du dommage
- Éliminer les agents nocifs et les tissus endommagés
- Rétablir la fonction tissulaire : "restitutio ad integrum" = réparation intégrale = guérison totale après une phase inflammatoire
Cependant, une cicatrice peut parfois persister, résultant de l’échec de la restitution intégrale.
- La détersion : Fondamentale dans le processus de réparation
- Détersion interne : Nettoyage du foyer lésionnel par phagocytose des cellules nécrosées et des agents pathogènes. L’œdème est aussi éliminé vers la circulation lymphatique.
- Phagocytes : Polynucléaires neutrophiles et macrophages digèrent les particules étrangères.
- Cette phase est essentielle pour éviter l'évolution de l'inflammation aiguë vers une inflammation chronique.
- Détersion externe : Nettoyage à l'extérieur des tissus enflammés, souvent nécessaire lorsque le tissu lésé est trop étendu.
- Spontanée (fistulisation) : Formation de pus ou de caséum, éliminé par fistule.
- Chirurgicale : Nécessaire lorsque la lésion est trop étendue ou contaminée, risquant d'entraîner une septicémie.
- Le bourgeonnement (granulation) : Formation du tissu de granulation
- Constituants : Leucocytes, fibroblastes (cellules conjonctives), et néo-vaisseaux sanguins.
- Migration des fibroblastes dans la zone inflammatoire, formant un tissu œdémateux et pauvre en collagène.
- Progressivement, le tissu devient plus riche en collagène et moins œdémateux, et la néovascularisation permet l'apport de plasma.
- Réduction du volume du bourgeon par diminution de l’œdème.
- Ce tissu permet le comblement de la perte de substance.
- L'épithélialisation : Formation d’un nouveau tissu de recouvrement
- Durée : Environ 1 à 3 semaines.
- Processus : L'épithélium se reforme de la périphérie vers le centre, recouvrant le tissu de granulation.
- Cela rend la plaie plus sèche en résorbant l’œdème et donne naissance à une nouvelle peau, d'abord fragile et rosée.
- Cicatrisation primaire : Lorsque la plaie est suturée (cicatrisation de 1ère intention).
- Cicatrisation secondaire : Dans les autres cas, bonne circulation est nécessaire pour une formation optimale du bourgeon charnu.
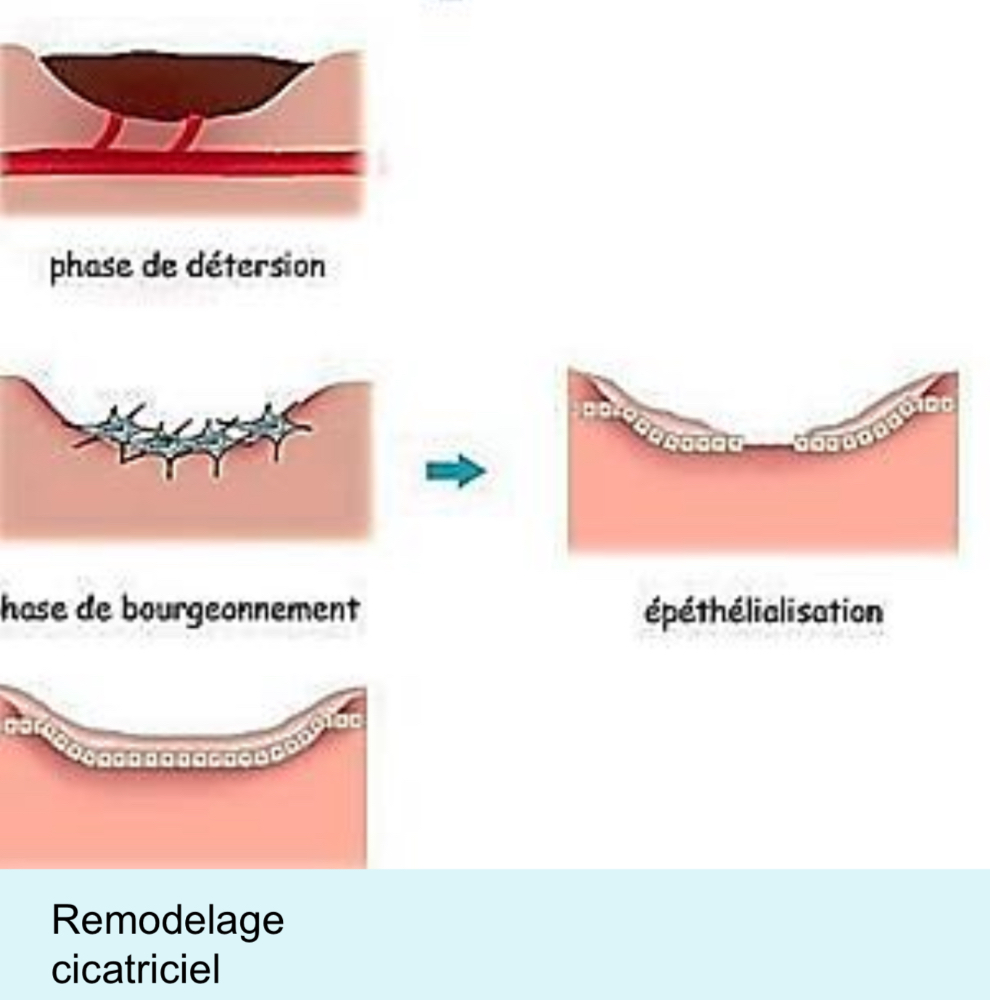
Schéma des différentes étapes de la cicatrisation tissulaire
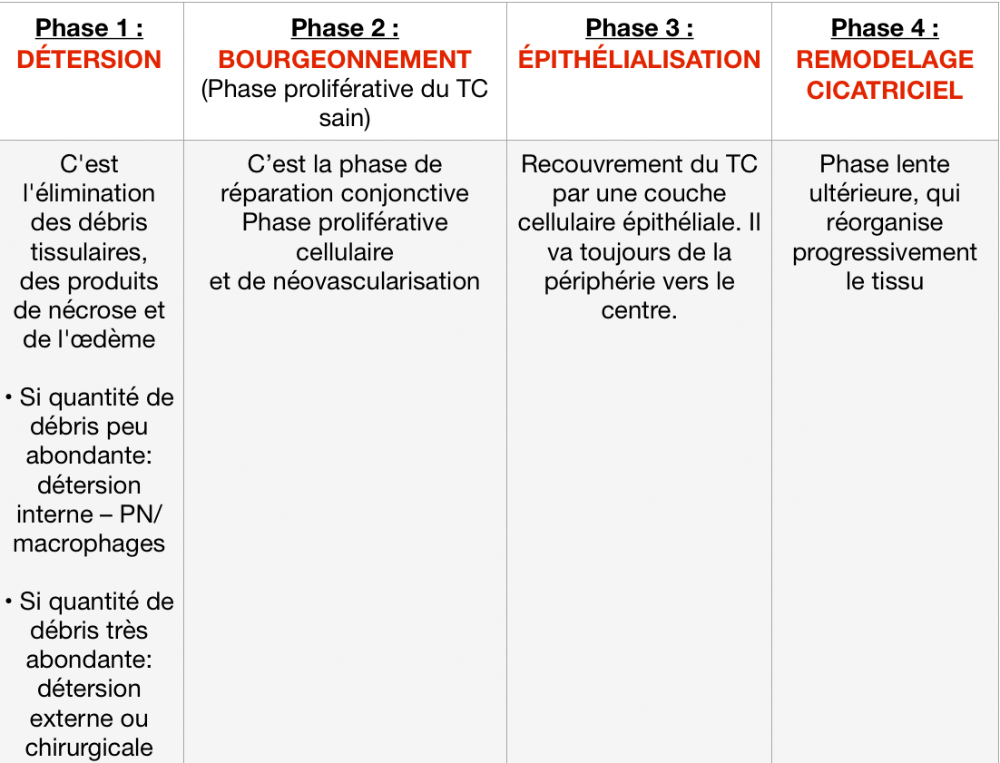
Tableau des différentes étapes de réparation tissulaire
- Cicatrice fibreuse :
- Formée par dépôt de tissu conjonctif riche en collagène.
- Structure moins élastique et plus dure que le tissu initial.
- Remodelage : La cicatrice devient plus souple, plus lisse et plus claire avec le temps (jusqu’à 2 ans).
- Cicatrice hypertrophique :
- Prolifération excessive de cellules cutanées et de collagène.
- Cicatrice chéloïde : Prolifération anormale des fibroblastes, entraînant une cicatrice plus volumineuse, souvent rouge et surélevée.
- Complications de la cicatrisation :
- Déformations superficielles : Par exemple, après une brûlure, liée à un excès de bourgeonnement.
- Cicatrices hypertrophiques et chéloïdes : Formation excessive de tissu cicatriciel.
- Traitement : Corticoïdes pour inhiber la prolifération cellulaire.
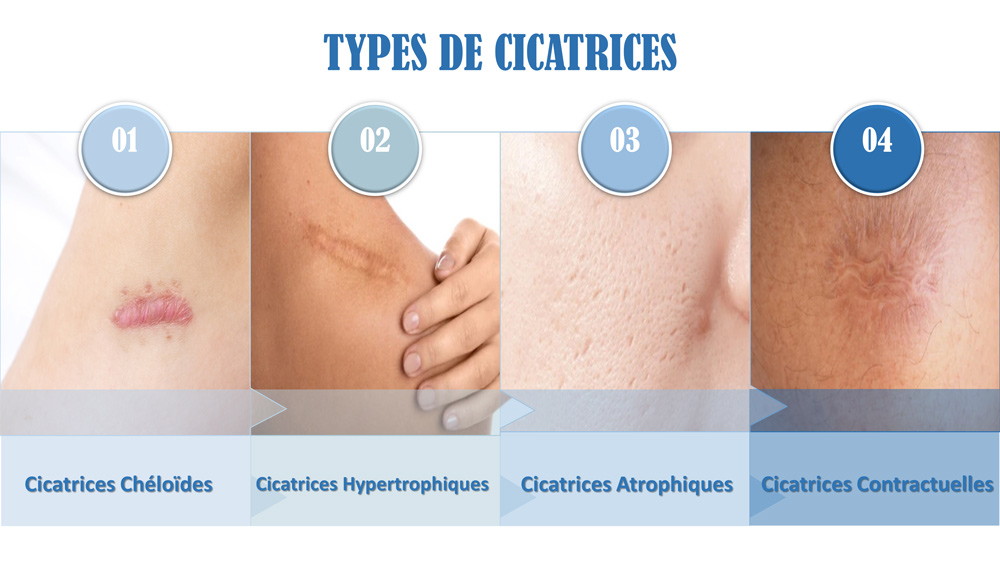
Schéma des différents types de cicatrices
Le processus de réparation tissulaire suit des étapes successives et immuables :
- Détersion : Nettoyage des tissus lésés.
- Bourgeonnement : Formation du tissu conjonctif pour combler la perte de substance.
- Epithélialisation : Formation de la peau de recouvrement.
Dans les cas idéaux, le processus aboutit à une restitutio ad integrum (réparation totale). Cependant, dans les cas moins favorables, il y a formation d’une cicatrice fibreuse, qui se remodelera avec le temps mais restera moins élastique et résistante que le tissu initial.