La pensée économique est un domaine complexe qui a évolué au fil du temps. Dans ce cours, nous allons explorer l'histoire de la pensée économique, en mettant l'accent sur les principales écoles de pensée et les théories qui ont façonné notre compréhension de l'économie.
Chap I : Introduction à la pensée économique
Définition
*L'économie était organisée de manière collective, ce qui signifie que les biens étaient possédés en commun par la société dans son ensemble plutôt que par des individus. De plus, Platon prônait une centralisation économique, c'est-à-dire que les décisions concernant la production et la distribution des biens étaient prises par l'État ou les dirigeants. Platon pensait que les échanges commerciaux pouvaient entraîner des inégalités sociales et corrompre la société. Par conséquent, il préconisait une économie où les biens étaient distribués selon les besoins de chacun, plutôt que selon la capacité à produire ou à accumuler des richesses individuelles.
Définition
*Salut (déf religieuse) : Fait d'être sauvé du péché et de la damnation.L'individu bénéficie donc d'une relation avec Dieu et a ainsi accès au Paradis.
**Réengager l’Église dans l’économie et social (Contexte) : St Thomas d'Aquin a permis le prêt à intérêt en le conditionnant à une pratique bienveillante envers les pauvres, conciliant ainsi les enseignements bibliques avec la réalité économique de son époque.
A retenir :
Définition de l'économie dans l'Antiquité :
- Production, Consommation, Répartition des revenus, Échange.
- Vues de Platon et Aristote.
Autres perspectives :
- Définition formaliste de l'économie.
- Concept de bonne et mauvaise chrématistique chez Aristote.
Pensée économique au Moyen-Âge :
- Contribution de St. Augustin et St. Thomas d'Aquin.
- Question du prêt à intérêt.
I. Les précurseurs de la pensée économique
Avant de plonger dans les écoles de pensée économique, il est important de se familiariser avec les précurseurs de cette discipline. De nombreux philosophes et penseurs ont contribué à l'émergence de la pensée économique telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Définition
Logique de match à somme nul :
"Si je gagne c'est que tu as perdu, si il y a match nul, on aura tous les deux perdus..."
Définition
// Quesnay proposait un tableau économique pour représenter les différentes classes sociales et montrer comment la richesse circulait dans l'économie, comparant le flux monétaire au flux sanguin dans le corps humain.
"La monnaie circule dans l’économie comme le sang circule dans le corps"
II. Philosophies Sociales de l'Individualisme Moderne
Problème de l'ordre social moderne :
Le passage de la société holiste à l'individualisme moderne fut accompagné de nouveaux défis concernant l'organisation sociale. Les Lumières (mvt européen) ont remis en question les croyances religieuses et ont promu des idées d'égalité et de liberté individuelle, conduisant à une réflexion sur la manière de maintenir l'ordre social dans ce nouveau contexte.
Aristote et St Thomas d'Aquin partagent une vision où la société n'est pas problématique. Pour Aristote, l'homme est un animal politique, et la cité est supérieure à l'individu, précédant celui-ci dans l'ordre social.
En revanche, St Thomas d'Aquin introduit la notion de transcendance divine, soulignant que dans la modernité, l'individu émerge progressivement en tant que sujet de droit. Il note également que dans les sociétés modernes, la théocratie, où Dieu est garant de la société, tend à disparaître, laissant place à d'autres formes de gouvernement.
Définition
Dans les sociétés anciennes, caractérisées par un holisme social, la hiérarchie est le principe fondamental.
Ce basculement est illustré par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, affirmant la liberté de tous les individus et la primauté de la volonté générale exprimée par la loi.
Définition
Hobbes et la nécessité de la pacification sociale
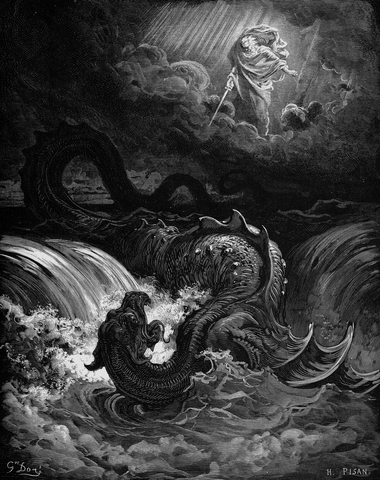
Ouvrage clé : "Léviathan" (1651)
A retenir :
Concepts clés :
- Individu selon Hobbes : Pour Hobbes, l'individu est un être atomisé, séparé des autres, doté d'une certaine liberté et de rationalité, mais surtout soumis à un instinct de conservation. Il est essentiellement mécanique et cherche à éviter la mort.
- "Le grand magasin de la nature" : Hobbes décrit l'environnement naturel comme un état d'insécurité radicale où personne n'échappe à cette vulnérabilité. Les différences naturelles entre individus ne sont pas significatives dans cet état de nature.
- Transition de l'état de nature à l'état social : La peur de la mort violente pousse les individus à passer de l'état de nature à l'état social. Cela se fait par un contrat social où les individus abdiquent leurs droits naturels d'auto-défense en échange de la garantie de protection de leur vie par l'État, représenté par le "Léviathan".
- Le contrat social : C'est un contrat d'association horizontale et un contrat de subordination verticale. Les individus, considérés comme égaux, créent artificiellement des institutions par le biais du Léviathan, qui les oblige à respecter ces institutions
Définition
- Ouvrage : "Traité de la nature humaine" (1739)
Définition
- Ouvrages : "Théorie des sentiments moraux" (1755) / "Richesse des nations" (1776)
Définition
Adam Smith et la maîtrise des passions
Sympathie : Smith considère l'homme comme un animal social, intrinsèquement lié aux autres par le désir de reconnaissance et d'approbation.
Le spectateur impartial : Concept où l'individu se met à la place de l'autre pour juger ses actions, cherchant l'approbation du spectateur impartial pour sa conduite morale.
Passion de l'enrichissement : Smith reconnaît que la sympathie peut enflammer cette passion, risquant de perturber l'ordre social si elle n'est pas régulée.
La main invisible : Les individus, en poursuivant leur intérêt personnel, contribuent involontairement au bien commun et à la richesse générale.
Économie politique : Smith distingue les phénomènes émergents des actions individuelles, mettant en avant l'ordre spontané de l'économie, critiqué par certains comme Keynes pour son potentiel d'équilibre de sous-emplois.
A retenir :
Concepts clés
Les philosophes politiques du contrat social, tels que Hobbes, Locke et Rousseau, ont proposé différentes visions de la manière dont l'ordre social pouvait être établi à travers un contrat implicite entre les individus et l'État.
Cette réflexion a donné naissance à des concepts tels que l'ordre volontaire et l'ordre spontané, qui ont influencé la pensée économique.
Adam Smith et la Naissance de l'Économie Politique Classique
Division du Travail et Richesse des Nations :
Adam Smith a souligné l'importance de la division du travail dans l'accroissement de la productivité et la création de richesse des nations. Il a comparé deux scénarios organisationnels pour illustrer les gains de productivité obtenus grâce à la spécialisation des tâches.
Théorie de la Valeur :
Smith a abordé la question de la valeur en distinguant les rendements croissants et décroissants dans la production. Il a également introduit le concept de la "main invisible", illustrant comment les actions individuelles des agents économiques contribuent au bien-être collectif sans intention explicite.
Philosophie Morale :
En plus de ses contributions économiques, Smith a développé une philosophie morale basée sur la sympathie et le désir d'approbation sociale. Il a mis en garde contre les dangers de la passion de l'enrichissement et a souligné le rôle de la société dans la régulation des comportements économiques
Définition
I. La division du travail, productivité du travail et richesse des nations
A. Division du travail et richesse des nations
Concept de division du travail : Fragmentation des tâches pour accroître l'efficacité.
Comparaison des scénarios :
Smith oppose une production sans division du travail à une production avec division du travail.
Effets de la division du travail :
- Accroissement d'habileté : La spécialisation permet à chaque ouvrier de devenir plus compétent dans sa tâche.
- Économie de temps : En se spécialisant, on évite la perte de temps lors du changement de tâche.
- Innovation et invention de machines : La division du travail favorise la création de machines et stimule l'innovation.
Échelles de division du travail :
- Intra-firme : Spécialisation des tâches au sein de l'entreprise.
- Marché national : Spécialisation entre les secteurs de l'industrie et de l'agriculture.
- Marché international : Spécialisation entre les nations.
Niveaux de division:
- Intra-firme : Au sein de l'entreprise.
- Sociale au niveau national : Entre les secteurs économiques.
- Sociale au niveau international : Entre les nations.
Théorie de la croissance vs théorie de la valeur :
- Croissance : Rendements croissants grâce à la spécialisation.
- Valeur : Rendements constants ou décroissants, excluant les rendements croissants.
A retenir :
La division du travail, en favorisant l'habileté, l'économie de temps et l'innovation, contribue à l'enrichissement des nations en augmentant la productivité du travail.
Cette division peut se produire à différentes échelles, de l'intra-firme à l'international, et entraîne des rendements croissants dans la théorie de la croissance.
A retenir :
Formules importantes :
Puissance productive du travail = Productivité du travail = Q / L
Si Q/L augmente, alors soit Q augmente avec L constant, soit L diminue avec Q constant.
Rendements croissants dans la théorie de la croissance, rendements constants ou décroissants dans la théorie de la valeur.

