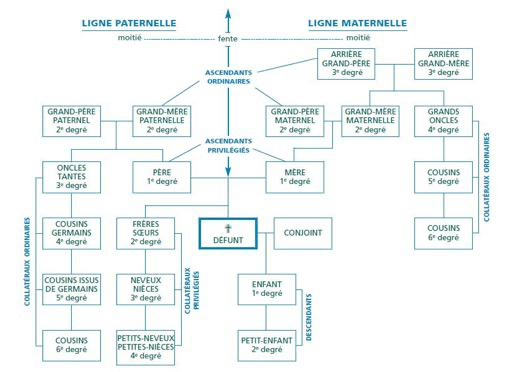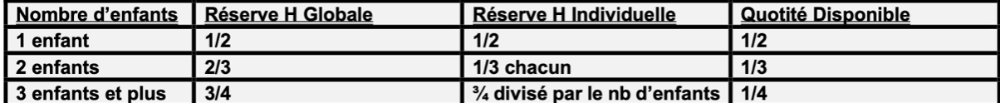Causes d’ouverture de la succession
Mort naturelle : la succession s’ouvre par la mort naturelle (C. civ., art. 720) qui est en principe constatée dans un acte de décès établi dans les conditions prévues aux articles 78 à 87 du Code civil. L’acte de décès est la fin de la vie juridique.
Disparition : le décès peut être judiciairement déclaré lorsqu'une personne disparaît dans des circonstances (exemple : naufrage) de nature à rendre sa mort très probable (C. civ., art. 88), et c'est ce jugement qui tient lieu d'acte de décès.
Absence : le jugement déclaratif d'absence, prononcé 10 ans après un premier jugement présumant l'absence, ou 20 ans après que la personne concernée a quitté son domicile sans plus jamais donner de nouvelles, emporte les mêmes conséquences que le constat du décès (C. civ., art. 128).
ATTENTION => présomptions simples : si le disparu ou l'absent réapparaît, les jugements sont annulés et ses droits sont restaurés (C. civ., art. 92, al. 1 et C. civ., art. 129 à 131).
Date de l’ouverture de la succession
Pour le décès : l'année, le mois, le jour et l'heure de la mort (C. civ., art. 79) sont fixés dans l’acte de décès. Présomption simple : preuve contraire possible par tous moyens
Pour la disparition : c'est la date fixée dans le jugement déclaratif du décès qui est retenue. La disparition doit émettre les circonstances que son corps n’a pas été retrouvé (art 88 du code civil). Cet article est produit pour pouvoir prendre une décision.
Pour l'absence : la date d'ouverture de la succession correspond à celle de la transcription du jugement déclaratif d'absence sur l'acte du décès (C. civ., art. 128, al. 1).
Une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou sa résidence sans avoir eu de ses nouvelles. Deux possibilités :
- Premier jugement du tribunal judiciaire qui constate une présomption d’absence. On attend ensuite un délai de 10 ans, et attend un jugement déclaratif d’absence qui fait acte de décès.
- Nous n’avons pas de jugement de présomption d’absence, pour avoir donc un jugement déclaratif d’absence il faut attendre 20 ans.
Lieu de l’ouverture de la succession : article 720
Les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt, et non à l'endroit où il meurt effectivement. Le 4 juillet 2012 et entré en France en vigueur en 2015 est dans l’UE, ce règlement européen prévoit comme lieu d’ouverture de la succession la loi de la dernière résidence habituelle du défunt.
Le futur défunt peut s’opposer à la loi de la dernière résidence habituelle en faisant le choix de sa loi nationale personnelle.