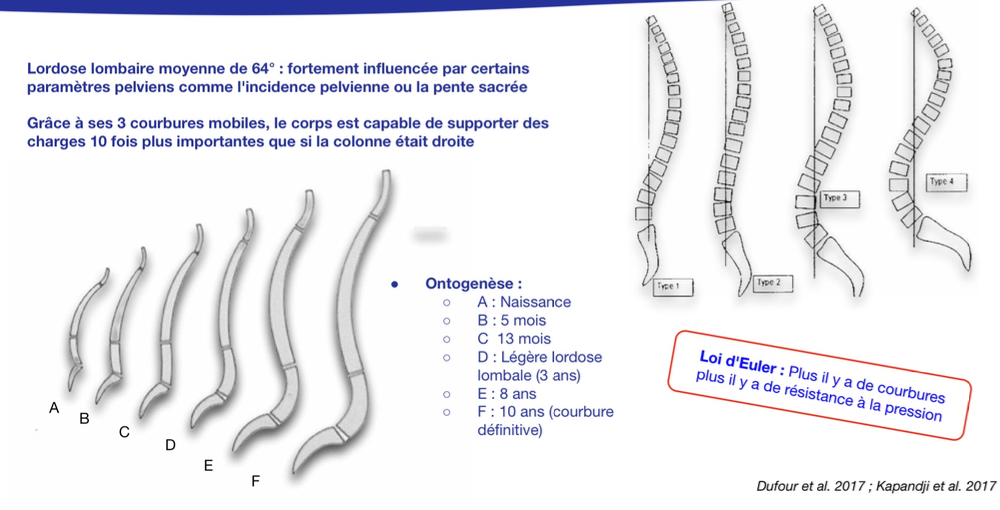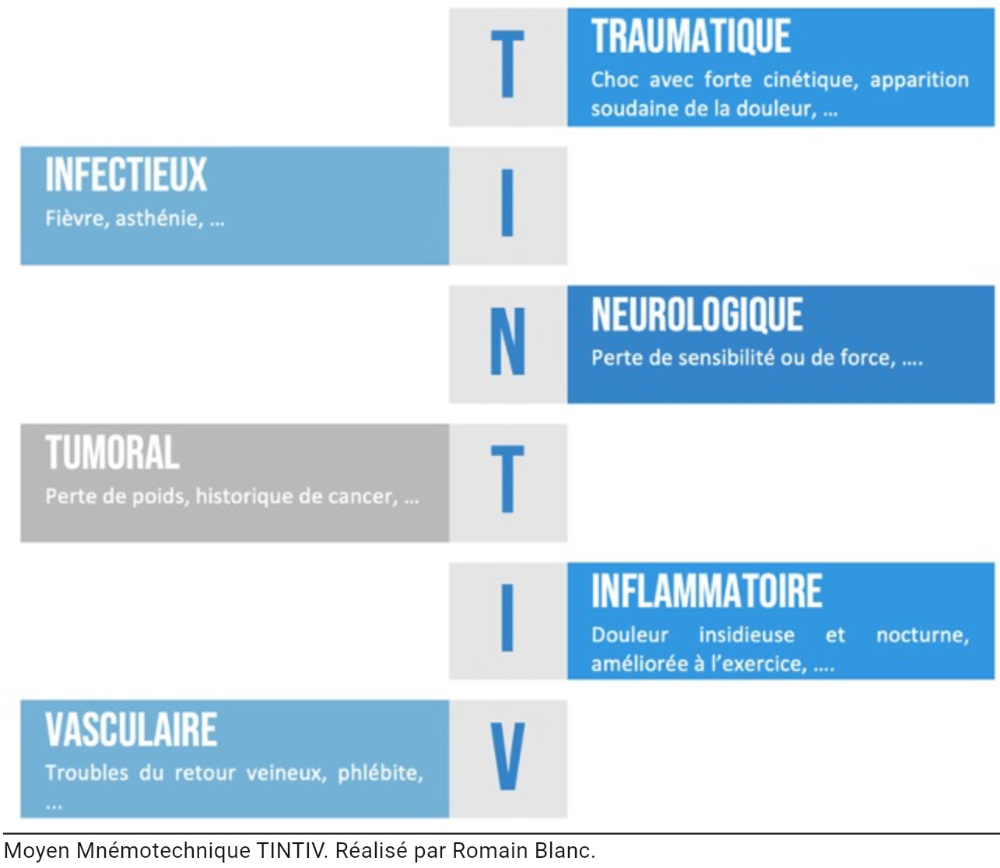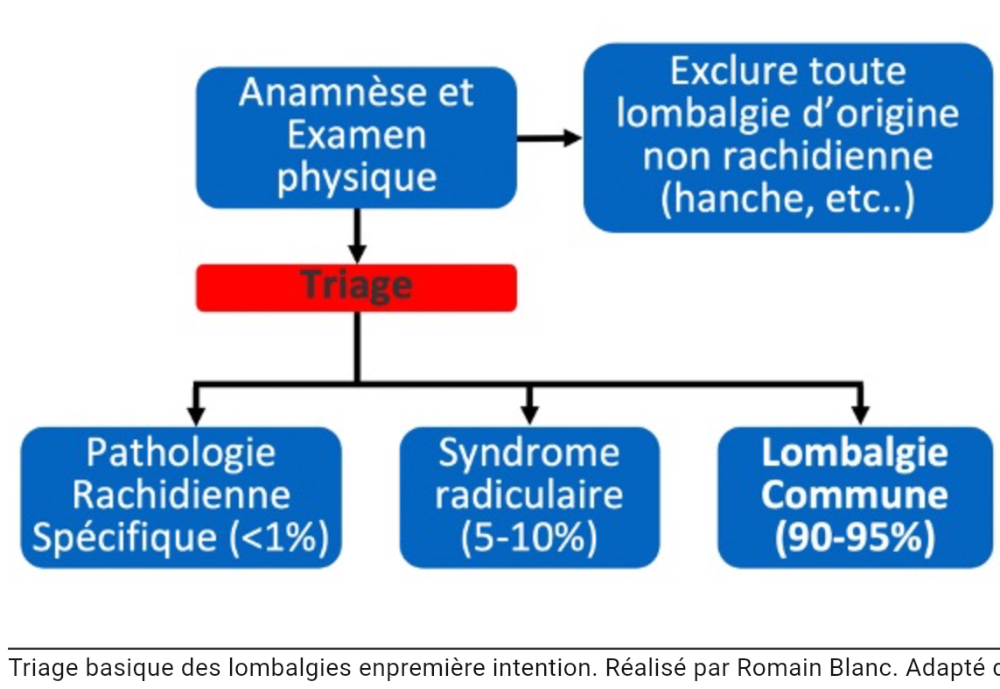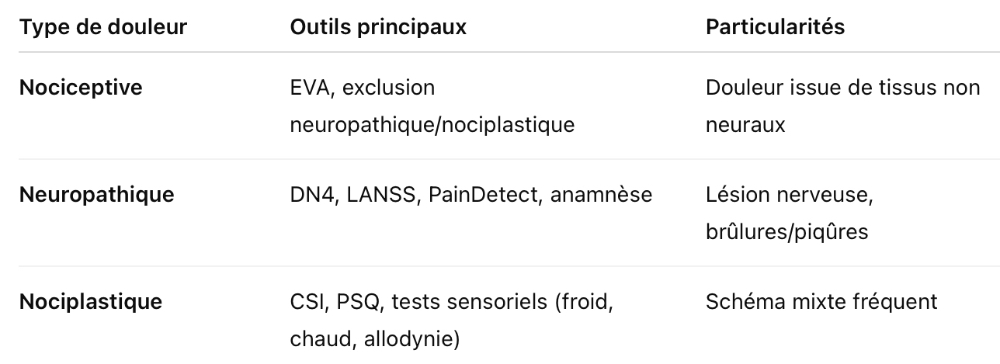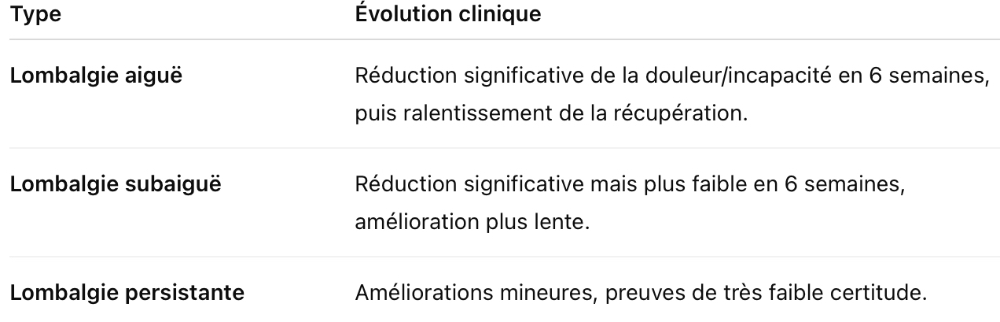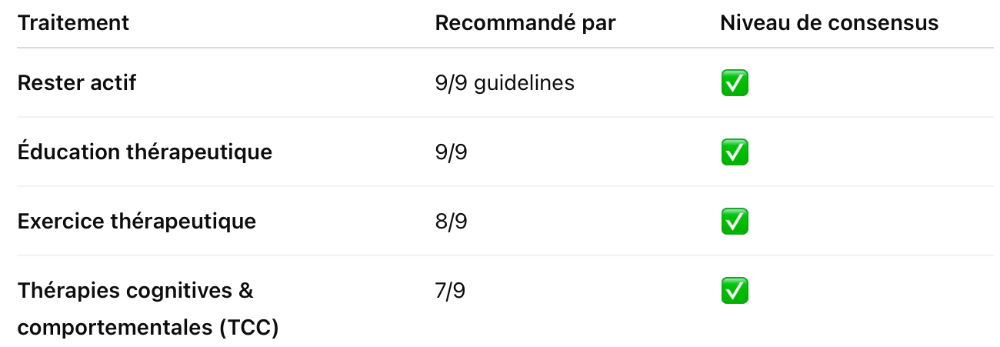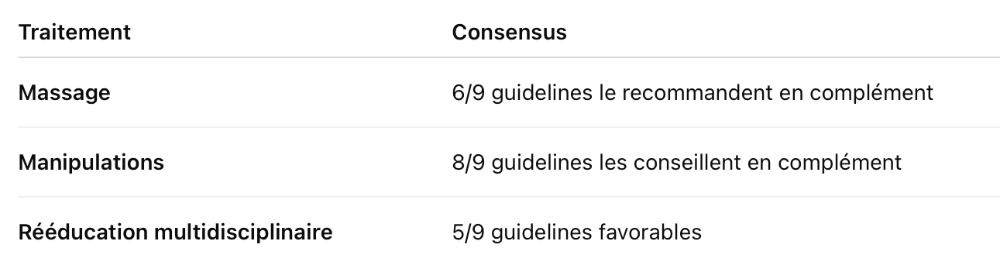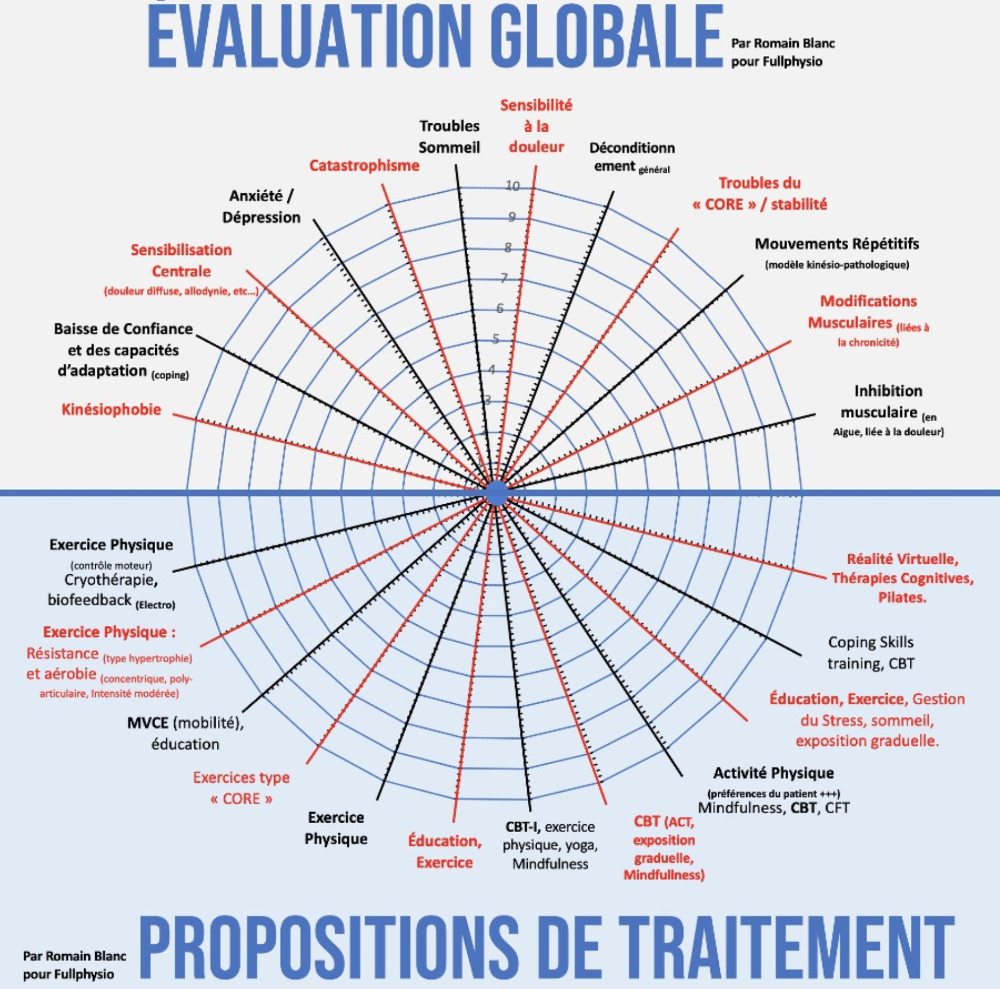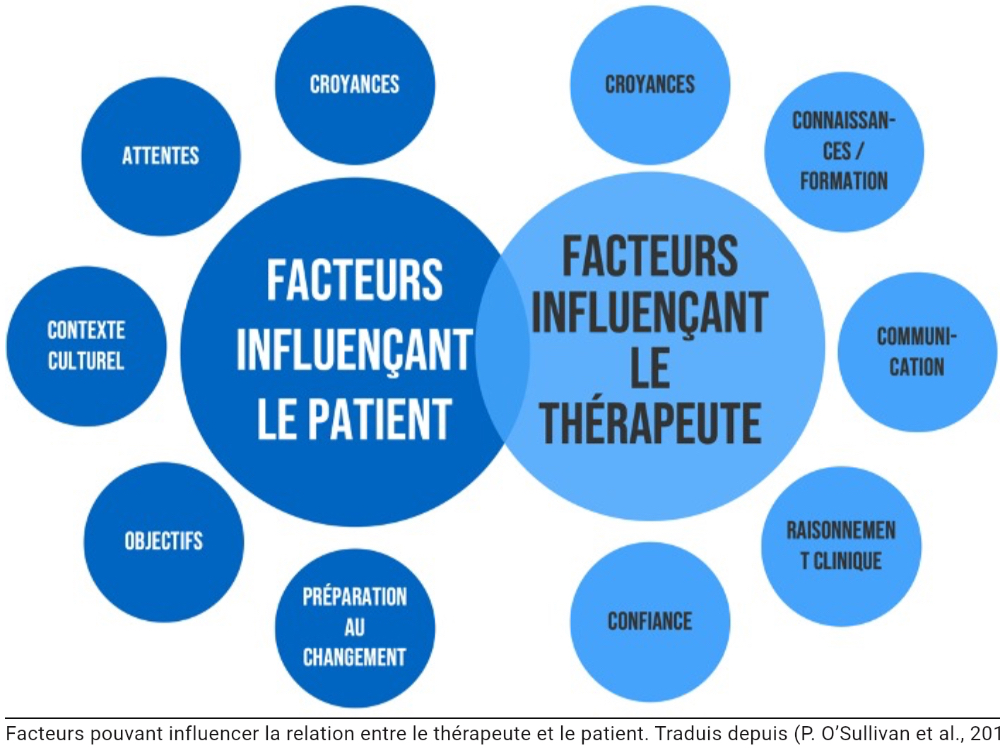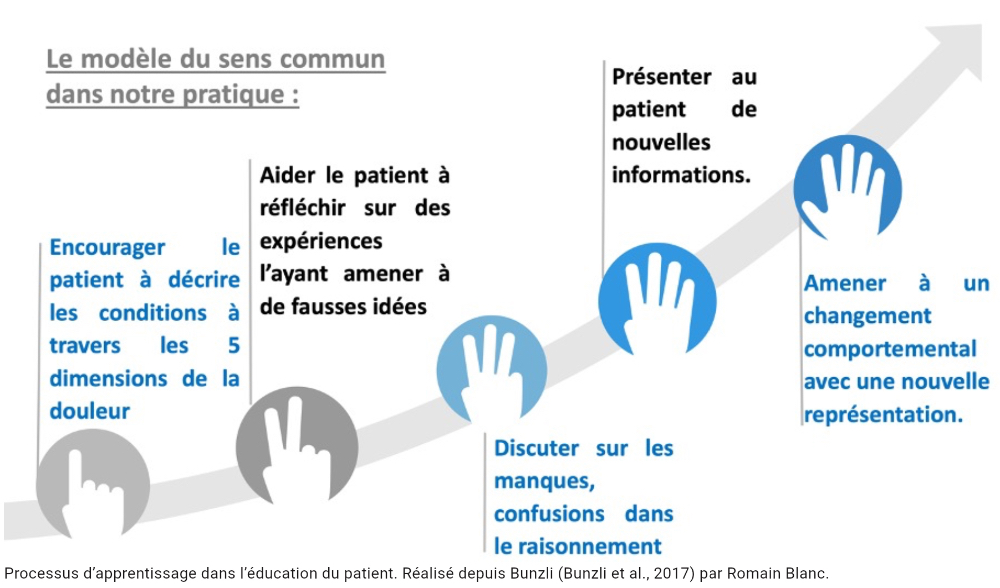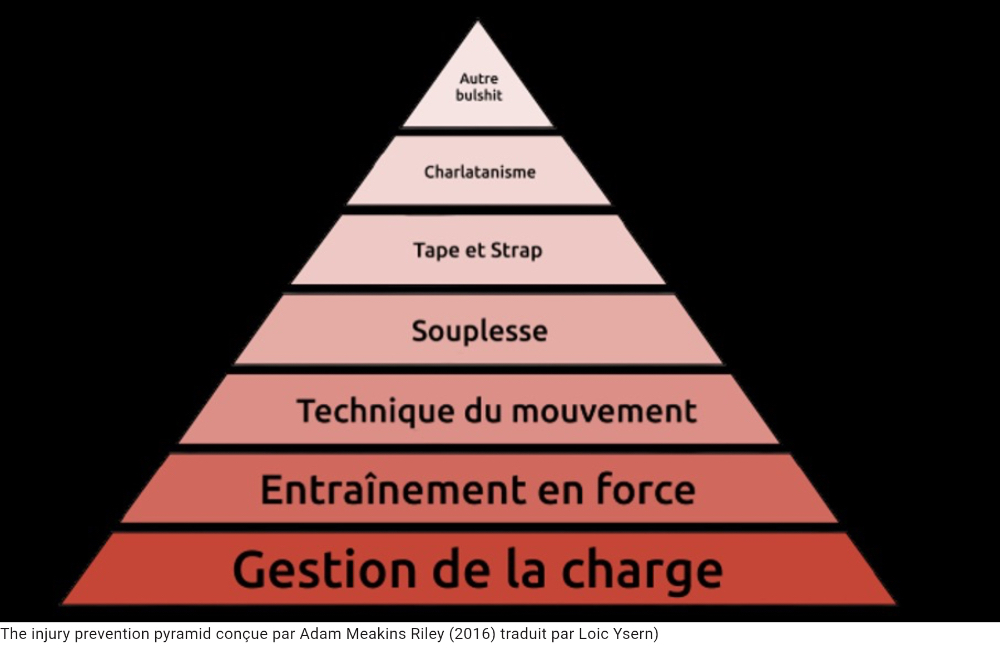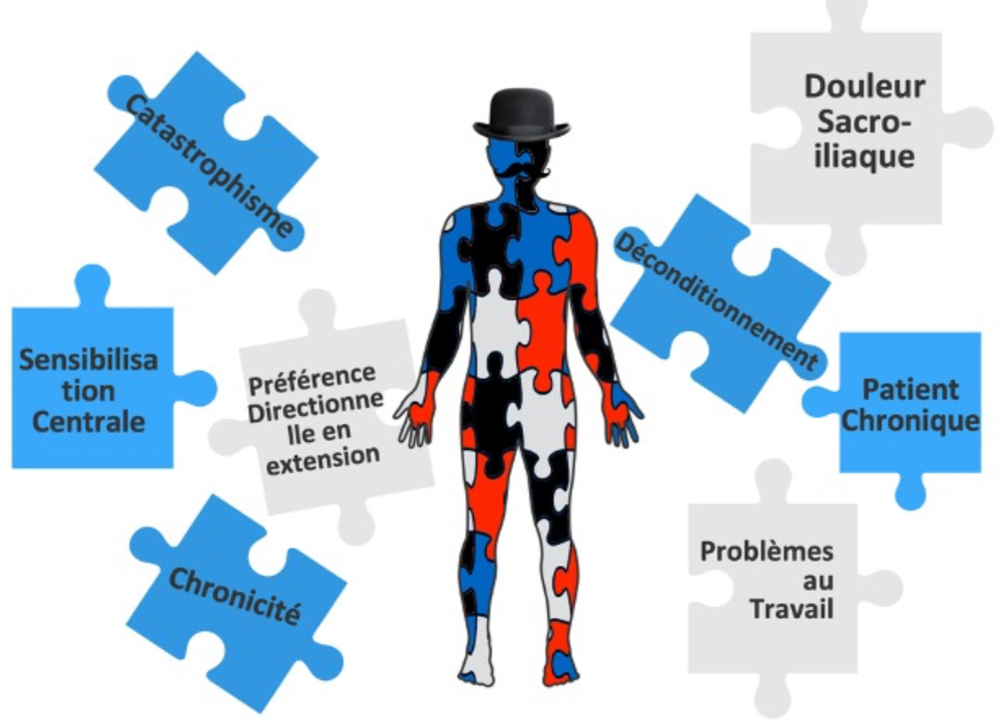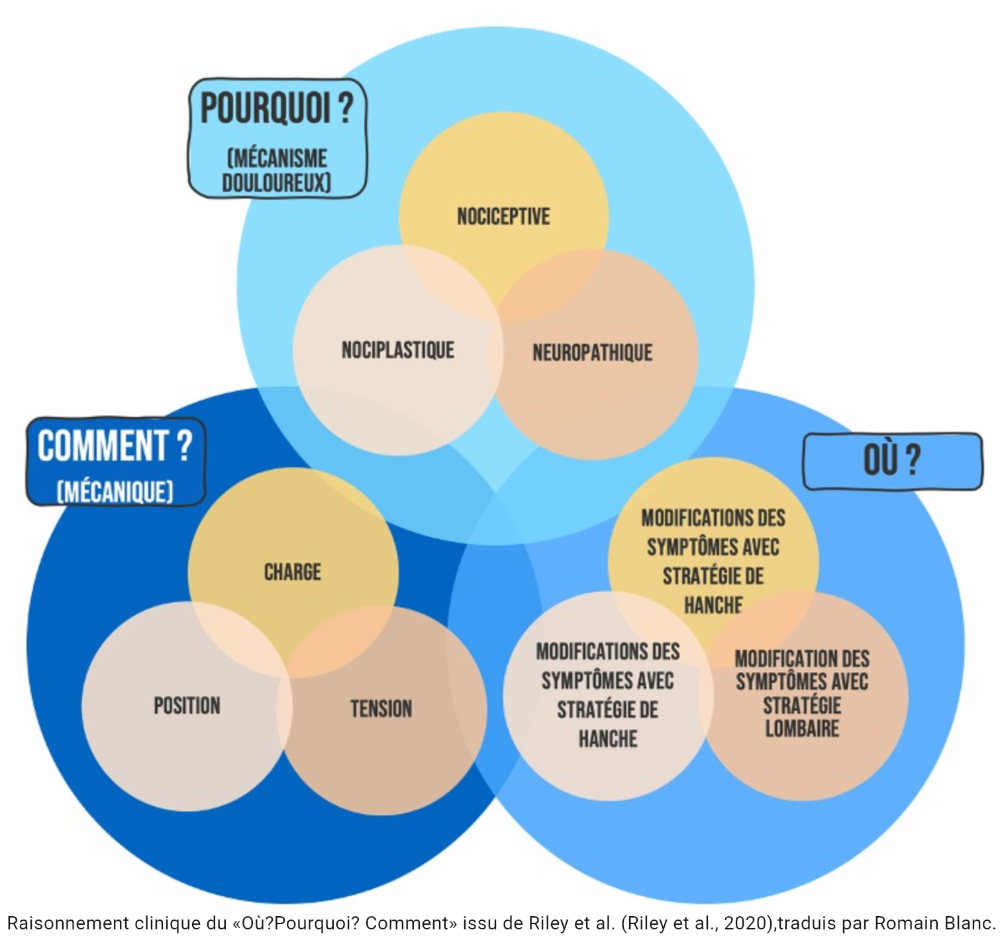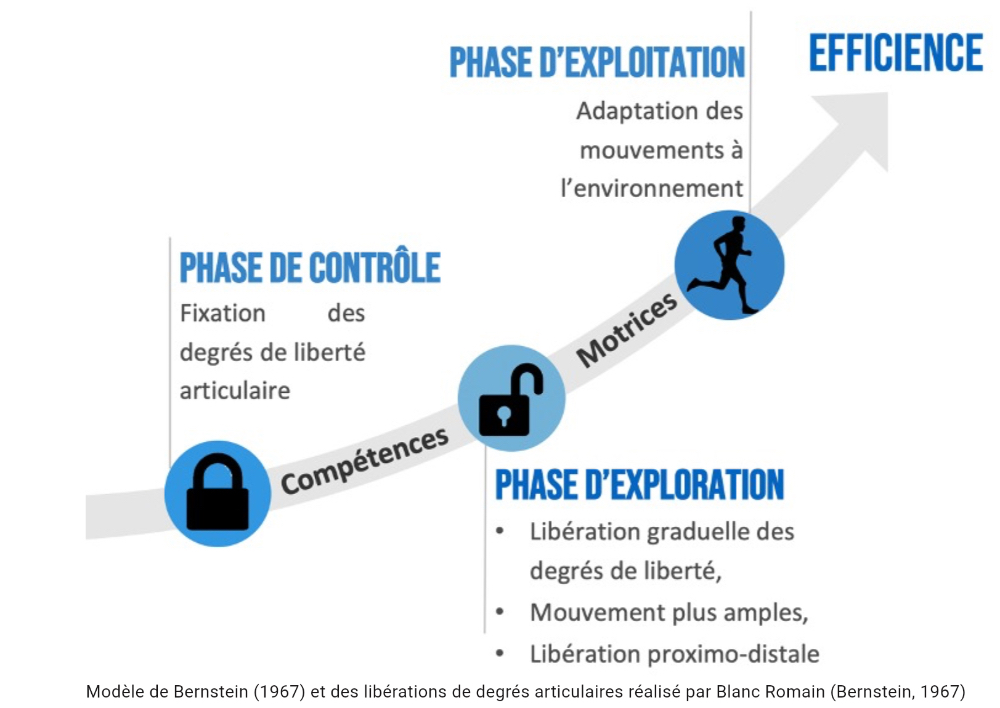1. Charnière thoraco-lombaire (T12–L1)
- Zone de transition entre le rachis thoracique (rigide) et lombaire (mobile).
- Soumise à des contraintes mécaniques importantes.
2. Rachis lombaire
- Composé de 5 vertèbres volumineuses.
- Présente deux parties principales :
➤ Partie antérieure
- Rôle : support du corps vertébral et du disque intervertébral.
- Point faible : partie antérieure du corps vertébral (travées osseuses moins denses).
- Fractures typiques :
- 600 kg → rupture de la partie antérieure (cunéiforme).
- 800 kg → rupture du mur postérieur.
- Travées osseuses = lignes de force de résistance.
➤ Partie postérieure
- Rôle : dynamique et de stabilisation (arc neural/vertébral).
- Composée de :
- 2 pédicules
- 2 lames
- 7 processus (4 articulaires, 2 transverses, 1 épineux)
- Protège la moelle épinière et forme le foramen vertébral.
📚 Réf. : Dufour et al., 2017 ; Kapandji, 2017
3. Disque intervertébral (DIV)
Structure :
- 3 parties :
- Nucleus pulposus
- Centre gélatineux (30–50 % du volume).
- 70–90 % d’eau.
- En tension permanente.
- Annulus fibrosus
- Anneaux fibreux autour du nucleus.
- 60–85 % d’eau.
- Collagène (65–70 % masse sèche) + protéoglycanes + quelques cellules.
- Plateaux vertébraux
- Plaques cartilagineuses reliant le disque aux corps vertébraux.
Rôles :
- Relie les vertèbres entre elles.
- Absorbe et répartit les chocs.
- Permet stabilité et mobilité.
- Tissu avasculaire (nourri par diffusion).
📚 Réf. : Liu et al., 2023 ; Isa et al., 2023
4. Courbure lombaire et ontogenèse
- Lordose lombaire moyenne : 64° (Evelinger et al., 2019).
- Influencée par l’incidence pelvienne et la pente sacrée.
- Absente à la naissance → apparaît avec la station assise et la bipédie.
- Loi d’Euler : plus il y a de courbures, plus la résistance à la compression est élevée.
- Les 3 courbures mobiles permettent de supporter jusqu’à 10× plus de charge que si la colonne était droite.
📚 Réf. : Bonnel et al., 2011 ; Dufour et Kapandji, 2017
5. Charnière lombo-sacrée (L5–S1)
- Dernière jonction entre la partie mobile du rachis (L5) et le bloc pelvien (sacrum).
- Zone à risque : plateau supérieur de S1 incliné vers l’avant.
- Spondylolisthésis :
- Glissement de L5 sur S1.
- Favorisé par une pente sacrée importante.
- Souvent dû à une lyse isthmique (fracture de fatigue).
- Variantes :
- Sacralisation (L5 soudée au sacrum → 4 vertèbres lombaires).
- Lombalisation (S1 détachée du sacrum → 6 vertèbres lombaires).
📚 Réf. : Dufour et al., 2017 ; Kapandji, 2017
6. Articulations et ligaments
➤ Articulations :
- 2 sacro-iliaques + symphyse pubienne.
- Articulation sacro-iliaque :
- Surface en L inversé.
- Mobilité faible (1–4° / 1–3 mm).
- Amortit et répartit les contraintes.
📚 Réf. : Lavignolle et al., 1983 ; Sturesson et al., 2000 ; Dufour, 2017
➤ Ligaments principaux :
- Ligament vertébral commun antérieur (LVCA).
- Ligament vertébral commun postérieur (LVCP).
- Ligament jaune.
- Ligaments inter-épineux, supra-épineux, inter-transversaires.
- Ligaments ilio-lombaires, sacro-tubéral, sacro-épineux → stabilisation lombo-sacrée.
📚 Réf. : Dufour et al., 2007 ; McGill et al., 2021
7. Système musculaire
➤ Muscles postérieurs
- Érecteurs du rachis (ilio-costal, longissimus, épineux).
- Multifides → stabilisateurs segmentaires (1–2 étages).
- Rotateurs courts → rôle proprioceptif.
- Contiennent beaucoup de fibres lentes (type I) → maintien postural.
📚 Réf. : Ward et al., 2009 ; Demoulin et al., 2007
➤ Muscles antérieurs
- Transverse, obliques int./ext., grand droit.
- Co-contraction avec les érecteurs → rigidité lombaire.
- Participent à la flexion, la rotation, la stabilisation et la respiration.
- Transverse :
- Véritable corset naturel.
- Activation réflexe lors des mouvements.
- Retard d’activation chez certains lombalgiques chroniques.
📚 Réf. : Richardson et al., 1999 ; Hodges & Danneels, 2019 ; Dufour et al., 2017
➤ Muscles profonds
- Carré des lombes : stabilise les vertèbres adjacentes.
- Ilio-psoas : stabilisateur lors de la flexion de hanche.
📚 Réf. : Bonnel et al., 2011
8. Stabilité selon Panjabi (1992, 2010)
Trois sous-systèmes interdépendants :
- Colonne vertébrale → structure passive.
- Muscles → stabilité active.
- Système nerveux central → contrôle neuromusculaire (feedback proprioceptif).
📚 Réf. : Dufour & Netter, 2010 ; Russo et al., 2018
9. Innervation du rachis lombaire
- 31 paires de nerfs rachidiens mixtes (racines motrices + sensitives).
- Nerf sinu-vertébral (de Luschka, 1850) :
- Innerve LVCA, LVCP, annulus fibrosus post.
- Douleur : diffuse, type viscéral.
- Branche dorsale du nerf spinal :
- Innerve facettes, muscles, ligaments, peau.
- Douleur : localisée, aiguë.
10. Biomécanique discale
- Le nucleus pulposus agit comme une rotule.
- En flexion → glissement antérieur du plateau supérieur.
- En inclinaison → le nucleus roule vers le côté de l’inclinaison.
- Répartition des charges :
- 75 % sur le nucleus.
- 25 % sur l’annulus.
- Adaptations :
- Compression → aplatissement + diffusion liquidienne.
- En décubitus → réhydratation (gain de taille le matin).
- Vieillissement → déshydratation → perte de souplesse et hauteur discale.
📚 Réf. : Kapandji, 2007 ; Liu et al., 2023
11. Anatomie vasculaire
- Tous les tissus rachidiens sont vascularisés sauf le disque intervertébral.
- Les veines vertébrales n’ont pas de valvules → drainage hydraulique sous pression.
- Fonction d’amortissement des chocs mécaniques.
12. Classification des lombalgies
➤ Selon la HAS (2019)
- Aiguë : < 6 semaines.
- Subaiguë : 6–12 semaines.
- Chronique : > 12 semaines.
- Récidivante : réapparition dans les 12 mois.
📚 Réf. : HAS, 2019 ; Urits et al., 2019
➤ Autres classifications :
- O’Sullivan (2005) :
- Perturbation du contrôle moteur.
- Hypomobilité / douleur mécanique.
- Hypersensibilisation centrale / facteurs psychosociaux.
- Maigne (2011) :
- Lombalgies rachidiennes (organiques).
- Lombalgies centrales (hypersensibilisation).
- Lombalgies sociales (facteurs psychosociaux).
- McKenzie (1990) :
- Syndrome de dérangement → amélioration avec mouvement préférentiel.
- Syndrome de dysfonction → douleur en fin d’amplitude.
- Syndrome postural → douleur liée à la posture.
📚 Réf. : Plantin, 2016 ; Deneuville, 2018 ; Sagi, 2011